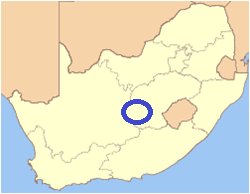La guerre de 1914-1918 verra une participation massive des Canadiens français par rapport aux conflits passés. À cette époque, en partie pour honorer des alliances conclues avec la Russie et la France, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne en août 1914.
Cette déclaration de guerre entraîne automatiquement le Canada dans le conflit, puisqu’étant une colonie de l’Empire britannique, le Canada n’est pas maître de sa politique étrangère. Par contre, le gouvernement canadien avait la liberté de décider de la nature de sa participation militaire.
1914-1915 : L’enthousiasme de la mobilisation
La plupart des Canadiens ont accueilli le déclenchement de la guerre avec enthousiasme. C’était particulièrement le cas de ceux qui étaient nés dans les îles britanniques, qui se sont portés volontaires en grand nombre. Ils ignoraient, ainsi que le reste du monde, les horreurs que les guerres allaient causer au XXe siècle.

Sur les affaires militaires, les Canadiens étaient aussi divisés sur la nature de la contribution à une guerre éventuelle menée en terre étrangère, un peu comme lors de la guerre sud-africaine dix ans auparavant. Sans doute dans l’effervescence du moment, en 1914, l’engagement des Canadiens à l’effort de guerre ne faisait aucun doute, mais c’est la capacité du pays à fournir une aide immédiate qui faisait défaut.
L’armée régulière canadienne avait un effectif d’à peine 3,000 hommes et quelque 70,000 réservistes sur papier. Le premier effort de constitution d’une armée avait en partie été possible grâce au travail du ministère canadien de la Milice qui était sous les ordres du très controversé Sam Hughes. Il avait mis en place à la hâte un camp d’entraînement à Valcartier en septembre 1914, juste au nord de Québec. Il ordonna aux 30,000 premières recrues de s’y rendre pour l’entraînement.
Sam Hughes a souvent été condamné par les historiens pour plusieurs erreurs de jugement. On lui reproche notamment d’avoir imposé aux soldats la carabine Ross fabriquée à Québec, sans parler du chaos administratif dans la mobilisation canadienne qui lui est imputé, de même que l’habituel patronage dans l’attribution des contrats militaires aux industriels et à la nomination des officiers. Cependant, on peut ajouter que Hughes a fait quelques bons coups. Par exemple, il examinait de près la qualité de l’entraînement que recevaient les recrues, il insistait sur le développement de leurs habiletés au tir, il a doté l’artillerie de canons modernes et accru les effectifs de la Milice.
Bref, et malgré tout, les recrues se réunirent et reçurent un entraînement à Valcartier (Québec). Au début d’octobre 1914, le premier contingent du Corps expéditionnaire canadien, constitué de 32 000 hommes, s’embarque pour la Grande-Bretagne. Ce premier contingent quitte pour l’Angleterre à peine sept semaines après l’entrée du pays dans le conflit, soit en octobre. Le premier contingent était composé à 70 % d’hommes nés dans les îles britanniques et récemment immigrés. Néanmoins, le corps des officiers était presque entièrement canadien et on dénote la présence d’environ 1,200 étaient Canadiens français dispersés dans l’ensemble des unités anglophones.

Ces francophones avaient été répartis au sein d’unités de langue anglaise composées en grande partie de ressortissants britanniques. De plus, le ministre Sam Hugues avait écarté du contingent les rares officiers supérieurs francophones, qui étaient membres de l’armée permanente. Le résultat fut que ce contingent devint la première Force canadienne à être mise sur pied, sans même que l’on se préoccupe d’y assurer une représentativité canadienne-française adéquate.
Au début du XXe siècle, rappelons-nous, l’anglais était la langue de commandement et il n’y avait que très peu d’officiers canadiens-français de la force permanente issus du Collège militaire royal de Kingston. Hughes ne voyait donc pas la nécessité de créer une unité francophone pour attirer des recrues du Québec.

Par conséquent, une délégation de politiciens fédéraux et provinciaux, des membres du clergé ainsi que certains hommes d’affaires vont faire un lobbying afin d’amener la création d’un bataillon francophone. Sous le leadership du docteur Arthur Mignault, qui était prêt à mettre 50 000 $ de sa fortune personnelle sur la table, le groupe argumente que l’unité nationale en temps de guerre est tributaire de l’intégration des Canadiens français au sein de l’armée permanente et à la formation d’un bataillon exclusivement francophone. Le 23 septembre 1914, dans une lettre adressée au Premier ministre Sir Robert Borden, Sir Wilfrid Laurier lui dit que la formation d’une unité canadienne-française connaîtrait un franc succès au sein de la population francophone. La proposition est retenue et le gouvernement donne officiellement son accord le 20 octobre.
Initialement connu sous la dénomination Régiment Royal Canadien-Français, le 22e Bataillon (canadien-français) sera désigné unité francophone tout simplement parce qu’il fut le vingt-deuxième bataillon d’infanterie autorisé pour le Corps expéditionnaire canadien (CEC). Sa véritable dénomination était le 22nd Infantry Bataillon (French Canadian). Le 21 octobre 1914, le 22e Bataillon (canadien-français) fait son entrée officielle au sein de l’institution militaire. D’octobre 1914 à mars 1915, l’entraînement de l’unité s’effectue à Saint-Jean-sur-Richelieu en banlieue de Montréal.
Les problèmes logistiques du site de Saint-Jean, le manque d’espace pour l’entraînement et l’attrait de la grande ville de Montréal (qui causera de nombreuses désertions et d’autres cas d’indiscipline) amènent le Colonel Frédéric Gaudet, le premier commandant du 22e Bataillon, à demander à plusieurs reprises le transfert de son unité vers un site plus approprié pour parfaire son entraînement. Suite à son insistance, sa demande est enfin acceptée et l’unité est déployée à Amherst en Nouvelle-Écosse, le 12 mars 1915, après avoir reçu ses drapeaux quelque temps auparavant le 3 mars. À cette occasion, lors de la bénédiction des drapeaux régimentaires, l’aumônier de l’unité, l’abbé Doyon, prononça ces paroles :
« …Il s’agit surtout d’une question d’existence nationale : pour les Canadiens français, il s’agit d’une question de vie ou de mort comme entité nationale, comme nation sur le continent de l’Amérique du Nord ».
À son arrivée à Amherst le 13 mars 1915, l’unité a reçu un accueil des plus glacials de la part de la population. Il fallait comprendre qu’une unité exclusivement francophone et méconnue de la population anglophone ne devait pas s’attendre à ce que les citoyens de la ville les acclament haut et fort. L’attitude de la population locale avait en partie été alimentée par diverses rumeurs qui circulaient sur le comportement des militaires canadiens-français et leur supposé tempérament festif.
Outre l’entraînement continu qu’il y poursuit, le 22e Bataillon ne tarde pas à s’impliquer activement au sein de la communauté. Conséquemment, à son départ pour l’Angleterre le 20 mai 1915, cette même population lui offre le plus vibrant salut, car nombreuses avaient été les collectes organisées par les soldats du 22e en vue d’aider des familles d’Ahmerst touchées par les difficultés économiques.
La traversée de l’océan se passa sans anicroche pour les 1,200 officiers et soldats du 22e embarqués à bord du Saxonia. Pendant l’été de 1915, le 22e est dans le sud-est de l’Angleterre à s’entraîner sous une chaleur torride. À la fin de l’été, un ordre arrive à l’intention du bataillon et cet ordre est clair : il faut ramasser armes et bagages, on part en France.
De Boulogne-sur-Mer, le 22e Bataillon fait une éreintante marche d’environ cinq jours pour arriver aux tranchées le 20 septembre 1915 en Belgique, non loin de la frontière français. Intégré au sein de la 5e Brigade de la 2e Division canadienne, le 22e Bataillon va connaître 38 mois de guerre et il va combattre avec les 24e, 25e et 26e Bataillons et, en toutes circonstances, il saura se distinguer.
La première année de guerre au front est un long et pénible apprentissage pour les soldats canadiens-français. De septembre 1915 à mars 1916, le 22e Bataillon tient un secteur de front dans les Flandres, dans le saillant d’Ypres en Belgique. Durant cette période, c’est principalement la guerre de tranchées et plusieurs raids qui seront menés.

En février 1916, le major Thomas-Louis Tremblay prend le commandement du bataillon et est promu au grade de lieutenant-colonel. Il sera commandant de cette unité jusqu’en août 1918, jour où il commandera la 5e Brigade d’infanterie canadienne à titre de brigadier-général. D’ailleurs, il sera le seul général francophone ayant commandé au front au cours de la Première Guerre mondiale. Alors qu’il n’avait que 30 ans, Tremblay aura a été le leader et l’inspirateur du 22e bataillon. Il écrit dans son journal :
«…Je comprends pleinement toute la responsabilité que comporte cette nomination…Mon bataillon représente toute une race, la tâche est lourde…Mes actes seront guidés par cette belle devise –JE ME SOUVIENS-. »
Alors que le 22e bataillon était constitué et commençait la guerre en Europe, on peut dire qu’une bonne partie de l’effort de guerre du Canada, du moins jusqu’en 1916, fut caractérisée par le chaos et l’improvisation à bien des égards. Et la question qui nous vient souvent à l’esprit est : pourquoi les hommes s’enrôlaient? On peut avancer certaines hypothèses.
Il est vrai que certaines notions liées au patriotisme, à la virilité, au désir de servir, à l’aventure, etc., ont incité bon nombre de Canadiens à s’enrôler. Cependant, le contexte économique difficile au pays en 1914 et les bons salaires offerts par l’armée ont dû en convaincre plus d’un de s’enrôler. Pour aider financièrement les soldats qui avaient des familles, le Fonds Patriotique Canadien, une organisation philanthropique, envoyait une aide à aux proches des soldats avec des fonds recueillis lors de souscriptions annuelles à l’échelle nationale.
Le salaire offert de 1$ par jour pour un soldat n’était pas le plus attrayant, mais les coûts de transports, de nourriture et de logement étaient couverts. À titre d’exemple, un employé de bureau ou un journalier gagnait à peine plus qu’un soldat en 1914, donc pour des hommes célibataires, l’armée offrait certes une possibilité intéressante d’échapper à la routine quotidienne… et pour certains à leurs obligations familiales.
Le coûteux apprentissage
Il est cependant difficile de dire dans quelle mesure les Canadiens étaient bien préparés lorsqu’ils allèrent pour la première fois au front en 1915. Nombreux, par exemple, étaient les problèmes avec la carabine Ross, les cartouchières qui tombaient, les canons en nombre insuffisant, tout comme les munitions. Les Canadiens français n’étaient pas plus préparés à la guerre des tranchées qu’aux nouvelles tactiques qui allaient émerger de l’expérience vécue sur le terrain.

Le début de l’année 1916 marque une impasse sur les fronts militaires. Les Canadiens prennent subitement conscience de toute la barbarie des combats. Les belligérants étaient depuis longtemps établis dans un complexe système de tranchées humides et inconfortables, protégées par des barbelés. Les hommes y vivaient pour se dissimuler et échapper au feu des mitrailleuses et de l’artillerie qui balayaient les champs de bataille. Une guerre d’usure coûteuse s’en suit pendant plus d’un an, et d’autres divisions canadiennes se joignent à la lutte. Une 3e et 4e divisions viendront compléter les formations du Corps canadien au cours de 1916.

À l’instar des combattants européens, les officiers et soldats canadiens expérimentèrent un long apprentissage de la guerre moderne. On a longtemps blâmé les généraux britanniques qui commandaient les Canadiens, mais nombre d’officiers canadiens n’avaient aucune expérience militaire, encore moins pour performer des tâches d’état-major. Donc, la période de 1915 à 1917 fut extrêmement coûteuse pour le Corps canadien, dans ce long et pénible apprentissage de la guerre des tranchées. Le 22e bataillon n’y a pas échappé.
Mont-Sorrel
La première véritable bataille du 22e bataillon fut défensive. Il s’agissait de repousser un assaut allemand pendant les deux premières semaines de juin 1916 en Belgique. Le 15 juin 1916, le bataillon occupe une position au Mont-Sorrel, près d’Ypres. Cette première grande bataille défensive a coûté au bataillon plus de 141 tués et blessés en quelques heures. C’était un premier vrai baptême du feu.
Flers-Courcelette
Le 1er juillet 1916, les forces franco-britanniques lancent une offensive majeure sur le front de la Somme. Le 15 septembre, c’est au tour du Corps canadien de prendre la relève d’une partie du front pour remplacer les Britanniques épuisés. Le 22e bataillon reçoit l’ordre d’attaquer un secteur délimité par les villages de Flers et Courcelette, puis de prendre et tenir cette dernière position. Ce sera l’une des plus grandes attaques du bataillon. En fait, ce sera sa première attaque d’envergure, qui début une année après son arrivée au front.
Le lieutenant-colonel Tremblay sollicite auprès du quartier général de la brigade l’honneur pour son bataillon de mener l’assaut, sachant très bien que ce sera un massacre. En demandant de mener l’attaque sur Flers-Courcelette, Tremblay était déterminé à prouver la vaillance et la haute distinction de ses hommes. Après avoir transmis ses ordres, il avertit chacune de ses compagnies que :
«…ce village (Courcelette), nous allons le prendre, et quand nous l’aurons pris, nous le garderons jusqu’au dernier homme. C’est notre première grande attaque; il faut qu’elle soit un succès pour l’honneur de tous les Canadiens français que nous représentons en France».

Le 22e perd environ le tiers de ses hommes sous les tirs d’artillerie et de tireurs d’élite au cours d’une marche de quelques kilomètres pour se rendre à ses positions de départ. L’assaut débute à 18h10, le 15 septembre 1916, sous un intense et efficace barrage d’artillerie. Rapidement, le bataillon avance dans les ruines du village. L’arrivée du bataillon coïncide avec la sortie en surface des Allemands, qui s’étaient cachés dans leurs abris souterrains « dug-out » au moment du tir d’artillerie. Il s’en suivit un terrible combat au corps-à-corps à la baïonnette, au poing, à la pelle, qui dura au bas mot une quinzaine de minutes. Après trois jours d’âpres combats, jour et nuit, le bataillon atteint son objectif, mais les pertes sont inquiétantes.

Des quelque 30 officiers et 900 hommes lancés à l’assaut, seulement 6 officiers et 118 hommes reviennent indemnes. La majorité des journaux du monde entier ont rendu hommage à la bravoure canadienne-française. À la fin de l’été et à l’automne 1916, les Canadiens combattent dans des conditions exténuantes pour ne progresser que de quelques kilomètres sur le front de la Somme.
La réputation des Canadiens était désormais établie. En octobre 1916, juste avant de quitter le front de la Somme pour le secteur de Vimy, le Corps d’armée canadien comptait quatre divisions d’infanterie soutenues par d’importantes forces d’artillerie, de cavalerie, de génie et auxiliaires, etc.
Par conséquent, le 22e bataillon pansait ses plaies et ramassait armes et bagages. Il fallait se rendre à Vimy. Rares déjà étaient les « vétérans » de 1914. Ils avaient été remplacés par les renforts qui, eux aussi, ont dû apprendre la guerre des tranchées, à partir des précieux conseils de ceux qui avaient fait Courcelette.