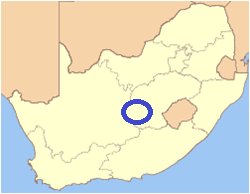Conférence prononcée à Saint-Georges (septembre 2007)
Bonsoir Mesdames et Messieurs,
Avant de commencer, j’aimerais vous dire à quel point je me sens comblé d’être ici parmi vous ce soir, et ce, pour deux raisons. D’abord, il m’est offert l’opportunité de parler avec vous d’un sujet qui me passionne, soit l’histoire militaire. Deuxièmement, je le fais parmi mes compatriotes, dans ce pays beauceron que j’ai abandonné pendant dix ans, mais pour lequel je suis revenu m’établir. Alors pour moi l’honneur est double, et je l’apprécie d’autant plus que je suis content de voir que vous avez pris la peine de vous déplacer pour m’entendre.
Cela dit, la conférence de ce soir porte sur un sujet qui m’est familier. En effet, malgré mon jeune âge (bientôt 30 ans!), cela fait une quinzaine d’années que je lis et que j’écris sur l’histoire militaire en général, mais pour laquelle je voue un intérêt particulier à tout ce qui a trait à ce qu’ont accompli nos militaires canadiens sur les champs de bataille de par le monde.
Par ailleurs, je suis historien de formation et je complète ma thèse de doctorat sur un sujet qui est, bien entendu, en lien avec le thème de ce soir. J’ai également eu l’opportunité d’enseigner l’histoire militaire et celle des relations internationales dans diverses universités au Québec.
Ce qui m’a amené à m’intéresser à ce sujet relève d’un événement en soi banal, peut-être. Je viens d’une famille, soit celle des Pépin vivant à Saint-Martin, où il y eut bon nombre d’hommes qui ont combattu au cours des deux guerres mondiales. Par exemple, mon grand-oncle Jean-Cléophas Pépin a servi dans trois armées nationales différentes. Il a d’abord combattu dans l’armée américaine en 1918, dans l’armée française en Afrique dans les années 1920 (alors qu’il servait dans un corps nommé la Légion étrangère), puis il a entraîné dans les années 1940, à titre de sergent-major, les militaires québécois qui eurent à faire la guerre en Europe. Je pense aussi à son frère, soit mon grand-père Raoul Pépin, qui a fait toute la campagne de l’Europe en 1944-1945, soit du débarquement en Normandie jusqu’à la fin de la guerre en Allemagne.
J’ai donc grandi dans cet univers où ma grand-mère me racontait les exploits de son mari et de son beau-frère, et le goût m’est venu assez jeune de lire davantage sur le sujet, ne serait-ce que pour donner un sens à ce que ces hommes ont fait.
L’objet de l’histoire militaire
Et c’est en lisant sur le sujet que je me suis aperçu, dans un premier temps, que l’histoire militaire, tant dans sa définition que dans ses objets de recherche, était relativement peu connue du grand public, et même des historiens! Pour faire court, je vous dirais que l’histoire militaire se veut une étude des conflits passés (et même présents!), mais c’est aussi une discipline qui couvre plus large. En effet, les chercheurs dans le domaine vont également étudier les sociétés en temps de guerre. Cela peut vouloir dire que l’on se penche, par exemple, sur le rôle des femmes, que l’on va étudier les économies de guerre, les arts, bref, tout un éventail d’aspects de la vie sociétale.
Et cette large définition et application des divers champs de recherche de l’histoire militaire peut tout aussi bien concerner le Québec. Je vous dirais qu’actuellement, nous avons au Québec un retard relatif dans l’avancement de nos recherches dans le domaine. Nous avons pas mal écrit sur nos batailles, mais les autres champs reliés à l’économie, au social, etc. sont encore relativement peu explorés.
Cela est vrai par exemple pour la société québécoise pendant la Première Guerre mondiale, qui est mon champ d’expertise. Et sur la Beauce même, on connaît assez bien l’histoire qu’on vécu les soldats beaucerons qui ont servi, par exemple, dans le Régiment de la Chaudière pendant la guerre de 1939-1945, mais on en sait relativement peu sur nos gens lors des autres conflits, de même qu’il reste encore de la recherche à faire sur la vie des Beaucerons qui ont vécu ici, en Beauce, pendant que leurs proches combattaient au loin.
Que savons-nous de notre passé militaire?
Ce dernier commentaire m’amène naturellement à une question que, probablement, certains d’entre vous se posent, à savoir : que savons-nous de notre passé militaire? Si, par exemple, on se promenait dans la rue et que l’on sondait les gens, qui pourrait nommer une bataille dans laquelle ont combattu les Québécois? Se rappellerait-on que nos ancêtres ont vécu l’enfer dans les ruines de Courcelette, en France, en 1916?
Ou encore, qui a déjà entendu parler de la bataille de Chérisy de 1918, en France? Sait-on qu’il s’agit probablement d’une des pires, sinon de la pire défaite de l’histoire du Québec? Qu’un régiment de 700 Québécois s’est fait anéantir en l’espace de 36 heures?
Est-ce que l’on se rappelle qu’en 1942, sur le sol rocailleux de Dieppe, en Normandie, le régiment des Fusilliers Mont-Royal s’est lui aussi fait tailler en pièce sous les tirs des mitrailleuses et des mortiers ennemis?
Voyez-vous, au risque de choquer les gens, je vais vous dire ce que je pense de la situation de notre soi-disant ignorance de notre passé militaire, d’après mon expérience comme historien et chercheur. Si on compare avec ce qui s’écrit et ce qui s’enseigne sur l’histoire militaire dans le Canada anglais, le Québec francophone fait carrément figure de parent pauvre. On ne sait à peu près rien de notre passé militaire.
Si on ne sait rien de notre passé, en particulier de notre passé militaire (qui est censé nous fournir des repères), comment peut-on prétendre à la compréhension des événements actuels, où nos militaires combattent en Afghanistan par exemple? L’actuel conflit en Afghanistan, qui est amplement couvert par les médias, ne fait que nous rappeler que l’engagement de nos militaires québécois suscite bien des interrogations, tant sur ce que font réellement nos soldats, que sur le sens de cette mission.
Dans un même ordre d’idées, je pense qu’il y a des éléments qui font en sorte que nous ne savons pas grand-chose de notre passé militaire. Certains m’ont dit que notre « ignorance » de notre passé militaire a débuté dans les années 1960-1970, alors que le Québec était dans sa Révolution tranquille et que le mouvement souverainiste avait parallèlement amené une réécriture de notre histoire. Si on part de ce principe, cela voudrait dire que l’histoire militaire aurait été progressivement écartée de l’enseignement de l’histoire générale.
Sur ce point, les études ont démontré qu’en effet, l’histoire militaire des Canadiens français était davantage enseignée dans les années 1950, qu’elle ne l’aurait été dans les années 1970 ou encore de nos jours. Les deux crises de la conscription, soit celles de 1917 et de 1942, auraient renforcé le postulat voulant que la philosophie de notre histoire québécoise découle d’une logique coloniale, soit d’une histoire « dominant/dominé ». Sauf que l’on oublie bien souvent que la crise de la conscription est un phénomène qui a touché l’ensemble du Canada pendant les guerres mondiales. Autrement dit, il n’y a pas qu’au Québec que des hommes ont refusé de s’enrôler.
Une autre raison qui expliquerait que l’histoire militaire des Québécois soit à peu près écartée des manuels scolaires serait que le volet militaire découle de la juridiction fédérale, autrement dit que tout ce qui concerne l’histoire attachée à ce volet ne relèverait pas de notre Ministère québécois de l’Éducation. Cela, je ne l’invente pas, ce sont des chercheurs sérieux qui me l’ont dit! En fait, si on présume que l’on vit au Québec, et qu’on enseigne néanmoins l’histoire du Canada dans nos écoles, alors pourquoi faudrait-il écarter l’étude de nos batailles? Vous voyez que le raisonnement ne tient pas debout.
Moi-même, alors que j’étais sur les bancs d’école au secondaire, au début des années 1990, on n’en parlait que très peu. Pire encore, l’an dernier, alors que j’enseignais un cours sur la Première Guerre mondiale à l’Université Laval, j’ai reçu deux chocs. Le premier, c’est que je devais former des étudiants qui deviendront nos futurs professeurs d’histoire au secondaire. Eh bien beaucoup d’entre eux étaient de parfaits ignorants de notre histoire militaire.
Le plus beau dans tout cela, c’est qu’ils en étaient au moins conscients, et ils m’ont régulièrement demandé pourquoi l’histoire militaire n’était pas enseignée dans les écoles secondaires, les collèges et les universités de cette province. Ces mêmes étudiants m’ont montré le programme d’histoire du Ministère québécois de l’Éducation. Je ne m’attendais pas à ce que l’on parle d’histoire militaire pendant 10 pages (ça aurait été trop beau!), mais j’ai été énormément déçu de constater que le volet initialement consacré à ce sujet avait été remplacé par une thématique aussi large qu’insignifiante intitulée « Le Québec socio-économique dans la première moitié du XXe siècle. » Ça en dit vraiment long sur nos intérêts face à notre passé collectif…
D’autres facteurs peuvent également expliquer nos manques de connaissances sur le sujet, ou encore le relatif manque d’intérêt. Il est vrai que par rapport au Canada anglais, ou même par rapport à des pays comme la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, nous n’avons pas un réseau de traditions militaires aussi bien développé que dans ces pays. Mais encore là, il ne faut pas se cacher derrière cet argument pour justifier l’inaction afin de rattraper le temps perdu au niveau de nos connaissances.
Même au niveau de l’armée, pour l’avoir vécu moi-même, j’ai constaté qu’un trop grand nombre de soldats ignoraient l’histoire de leur propre régiment! Comment voulez-vous forger un soi-disant esprit de corps au sein d’une troupe si les gars sont ignorants de l’histoire de leur unité, parce que de cette histoire découlent aussi des traditions qui finissent par renforcer le sentiment d’appartenance à ladite unité. Et par le fait même, comment voulez-vous instruire le peuple sur son propre passé militaire, si ses soldats l’ignorent eux-mêmes?!
Il existe certes des solutions, puisque la situation n’est pas si désespérée que cela. J’y reviendrai un peu plus tard, car au lieu de se morfondre toute la soirée sur notre ignorance, pourquoi ne pas parler de ce que l’on sait, ou à tout le moins de ce que l’on devrait savoir? On jase après tout!
Ce qu’ont vécu les soldats canadiens-français (québécois)
Depuis déjà quelques minutes que je vous entretiens sur l’état de notre passé militaire au Québec, il serait pertinent, je crois, d’illustrer le tout par des exemples. En fait, si l’on s’en tient aux conflits à une époque moderne, essentiellement ceux du XXe siècle, nos ancêtres ont vécu des expériences que je qualifierais simplement d’« inoubliables ». Je procéderai en suivant une chronologie bien simple pour illustrer mon propos, soit en commençant avec la guerre de 1914-1918.
Quand le Canada entre en guerre contre l’Allemagne en 1914, le pays n’avait pour ainsi dire aucune armée digne de ce nom. Ce que l’on appelait l’« armée » à l’époque était en fait une sorte de milice active permanente composée d’à peine 3,000 hommes, dont la plupart savait tenir un fusil, mais l’équipement et l’entrainement étaient plus que déficients. Bref, quand la guerre éclate, ils sont des milliers de Canadiens anglais et de Canadiens français à se présenter aux casernes.
Et mes étudiants me demandaient fréquemment pourquoi les hommes à l’époque s’enrôlaient. Plusieurs raisons les ont poussées à s’embarquer dans cette aventure pour laquelle ils ne pouvaient à tout coup prévoir les conséquences. Car c’est cela qu’il faut bien comprendre, lors que les Canadiens français et les Beaucerons d’ici s’enrôlent dans une caserne à Québec, chacun a ses raisons. Oui, c’est vrai, certains l’ont fait par esprit de patriotisme, mais je vous dirais que, dans le contexte québécois de l’époque, il s’agissait d’une minorité. Même si tout le monde aime son pays, peu de Québécois se sont enrôlés explicitement pour la défense du Canada, encore moins pour aller secourir la France, notre ancienne mère-patrie.
En fait, le Canadien français moyen qui s’engage en 1914 le fait parce que c’est payant, un point c’est tout. Comme le Canada, le Québec traversait une époque plus que morose sur le plan économique. Il n’y avait pas du boulot toute l’année, et dans une région comme la Beauce, vu qu’il fait froid la moitié de l’année, les temps étaient durs sur la terre, les chantiers de bois étaient souvent saturés, car notre économie était dépendante de celle du voisin américain, etc. Pour vous donner une idée, en 1914, l’armée canadienne donnait 1$ par jour à tout homme qui s’enrôlait. Si on traduit en dollars d’aujourd’hui, cela ferait autour de 50$ par jour, en plus du fait que vous êtes logés, nourris et vêtus!
De plus, tout le monde se disait que lorsque la guerre a commencé en août 1914, soit en plein été, le conflit européen serait terminé à Noel. Donc, en bon français, on va faire un peu d’armée pour « faire une passe de cash », et on rentre à la maison à l’hiver, avec un peu plus d’argent. Mais comme vous le savez probablement, la réalité a été toute autre, et cette guerre a duré plus de quatre ans, quatre ans d’enfer dans les tranchées de France et de Belgique.
Et dans ce contexte, alors que l’anglais était la langue officielle de l’armée, beaucoup de politiciens du Québec ont fait pression pour que soit mis sur pied un bataillon de langue française, ainsi naissait en octobre 1914 le célèbre 22e bataillon (canadien-français), mieux connu aujourd’hui sous le nom de Royal 22e Régiment. Ce bataillon-là est arrivé au front à l’automne de 1915 et a fini la guerre en Allemagne au début de 1919. Pour vous donner une idée, j’ai recensé au moins une centaine de Beaucerons qui ont servi dans cette unité, à l’époque commandée pendant une large partie du conflit par le jeune lieutenant-colonel Thomas-Louis Tremblay.
Pour ceux et celles plus âgés parmi nous, il ne faut pas non plus s’étonner si l’on ne sait pas grand chose de ce que ces gars-là ont fait pendant la guerre de 1914-1918. En fait, et ça s’applique pour tous les conflits à vrai dire, comment voulez-vous expliquer à vos familles toutes les horreurs que vous avez vues là-bas? Comment pouvez-vous leur expliquer la sensation de charger l’ennemi avec la baïonnette au canon, d’entrer dans un village, de frapper sur un adversaire avec toutes les armes qui nous tombent sur la main, de voir son meilleur ami tomber à ses côtés?
Dans une guerre comme celle de 1914-1918, le pire ennemi des soldats québécois, en plus d’avoir à affronter les Allemands, était d’endurer les misères quotidiennes. Je vous dirais que la pire d’entre elles était la boue, la « crisse de bouette » comme disaient nos ancêtres. À peine vous êtes dans la tranchée que, lorsqu’il pleut, l’eau monte rapidement. Le problème, c’est que vous devez rester là, ce sont les ordres. Les soldats attrapaient des rhumatismes, vivaient avec les rats, la vermine, devaient endurer d’autres petites misères comme le casque qui vous chauffe et qui vous gratte la tête, les cartouchières qui vous donnent mal au rein, la boue qui vous rente dans les bottes malgré que vous êtes certain de bien les avoir attachées.
Comment, lorsque vous revenez au pays (pour ceux qui reviennent), pouvez-vous expliquer cela à vos familles? Ce qu’on entend souvent des témoignages des vétérans sont des faits qui ont trait à des moments plus heureux. Parce que, oui, il y a eu des beaux moments à la guerre. Pour bon nombre de soldats, leur véritable famille a été les quelques « chums » de leur section avec qui ils ont fait la guerre, avec qui ils ont enduré les combats, avec qui ils se sont saoulés dans une taverne derrière le front. C’étaient de véritables frères d’armes.
Imaginez-vous. On est à Courcelette, dans le nord de la France, en 1916. Dans le village se trouvent les Allemands. En face, les soldats canadiens-français du 22e bataillon. Ceux-ci sont environ 800, à attendre le signal de l’assaut. Puis vient le moment fatidique, la fameuse minute pendant laquelle nos canons arrêtent de tirer sur l’ennemi pour nous permettre d’avancer. C’est un moment qui nous paraît une éternité, où le cerveau fonctionne comme dans un film au ralenti, et le bruit strident des sifflets des officiers se fait entendre. C’est le signal de la charge.
Pendant les trois jours et trois nuits qu’a duré la bataille de Courcelette, les Canadiens français ont été coupés du reste du monde. Au sortir de la bataille, il restait 118 soldats encore debout, sur les quelques 800 qui avaient initialement chargé! Cette bataille-là a été un massacre, et les hommes qui sont sortis de là ne pouvaient assurément plus percevoir la vie comme auparavant. Et pendant bien longtemps, jusqu’en 1939 au moins, Courcelette était pour les Québécois la bataille des batailles, et non pas celle de Vimy, comme on nous parle souvent de nos jours.
Bref, je me suis attardé longuement sur cet exemple pour vous illustrer ce qui attend ceux et celles qui explorent l’histoire militaire. Mais il ne faut pas oublier que d’autres conflits sont venus également forger la vie et le caractère de ceux qui y ont participé. Comme je le mentionnais précédemment, des Québécois ont débarqué en 1942 sur la plage de Dieppe, alors occupée par les Allemands. Le régiment des Fusilliers Mont-Royal, qui comprenait alors quelque 550 hommes s’est fait massacrer. C’était là la tentative faite par des Québécois de libérer une parcelle du sol de la France. Et on a remis ça deux ans plus tard. Mieux préparés, mieux équipés et entraînés, nos soldats sont revenus en Normandie, ayant appris bon nombre de leçons du désastre de Dieppe.
On peut, dans ce contexte, imaginer la réaction des Français à l’arrivée des gars du Régiment de la Chaudière, alors la seule unité canadienne-française, en grande partie composée de Beaucerons, à avoir attaqué la plage le premier jour du débarquement. Ces hommes-là se sont battus comme des lions contre les Allemands, notamment contre les soldats des Jeunesses hitlériennes. Les combats dans les villages et les forêts de Normandie ont aussi été sans pitié, surtout face à un adversaire qui n’avait pas tendance à faire des prisonniers.
Les Québécois ont été sur bon nombre de champ de bataille pendant la guerre de 1939-1945. Il y avait certes le Régiment de la Chaudière en Europe du Nord en 1944-1945, mais d’autres unités ont aussi combattu. On pense notamment au Régiment de Maisonneuve et des Fusiliers Mont-Royal, dont ce dernier, après le désastre de Dieppe, fut reconstitué et revint pour la bataille de Normandie. Et bien sûr, le Royal 22e Régiment, qui pour sa part a fait principalement compagne en Italie entre 1943 et 1945. Cette dernière campagne est d’ailleurs largement oubliée de nos jours.
Tout comme on oublie également la guerre de Corée, une guerre elle aussi sans merci, qui a duré de 1950 à 1953, à une époque où le monde « libre » tentait d’endiguer la progression du communisme à travers la planète. Nos soldats y étaient, dans ces montagnes asiatiques, dans un conflit que semblait même oublier la société québécoise de l’époque.
Et que dire des diverses missions qu’ont effectuées nos militaires sous les mandats des Nations-Unies ou de l’OTAN en Afghanistan présentement? J’ai souvent entendu dire, par exemple, que les Casques bleus s’imposaient entre deux factions ennemies, sans pouvoir utiliser leurs armes, sauf en cas de « légitime défense ». Pour avoir parlé à bon nombre de vétérans des missions des Nations-Unies, et même de soldats revenus d’Afghanistan, du carnage, il y en a eu. Et bien qu’il y ait sans doute eu moins de morts à la minute et au mètre carré qu’en 1914-1918 ou en 1939-1945, perdre un ami, c’est perdre un ami. Les souffrances sont les mêmes, souffrances qui sont souvent accentuées par l’impression d’un sentiment d’abandon d’une société préoccupée par ses réalités quotidiennes locales.
Le devoir de mémoire
C’est pour cela que, je pense, il ne faut jamais oublier nos soldats. Il ne faut pas oublier leurs gestes, leurs souffrances et, par-dessus tout, les leçons qu’il faille tirer des conflits, dans l’espoir peut-être naïf que plus jamais cela se reproduira. Il faut toujours se rappeler que les Québécois qui ont combattu dans les guerres du monde étaient certes des soldats, mais c’était avant tout des hommes. C’étaient des hommes avec leurs qualités comme avec leurs défauts.
Ceux qui par exemple ont combattu en 1939-1945 ont au moins 80 ans, sinon plus. Beaucoup parmi eux m’ont raconté que leur pire souvenir, ce n’était pas nécessairement les Allemands et le fait d’en avoir tué, mais juste de penser que ces Québécois qui ont aujourd’hui 80 ou 85 ans, ont eu 20 ans à une certaine époque. Leurs amis aussi avaient 20 ans, mais ces derniers auront toujours 20 ans dans l’esprit de ceux qui s’en sont sortis physiquement indemnes.
Certains vont davantage parler de ces beaux moments de camaraderie, où la communauté des frères d’armes était plus solide que le feu ennemi. C’est en ce sens que nous avons un véritable devoir de mémoire envers ces hommes et ce qu’ils ont fait. Par exemple, le fait de participer chaque année aux commémorations, le 11 novembre, est un message que l’on envoie à ces hommes et à ces femmes que leurs sacrifices et leurs histoires ne seront pas oubliés. Mais d’autres gestes peuvent être posés et qui ont une portée tout aussi significative.
Les années passent et vous avez comme moi que les vétérans vont disparaitre aussi. Plusieurs d’entre eux ont des choses à dire et il faut simplement prendre le temps de les écouter. En fait, l’expression « devoir de mémoire » est peut-être inadéquate, car cela ne devrait pas être un devoir au sens d’accomplir une obligation. Il faut tout simplement les écouter.
Et l’une des belles initiatives que l’on peut poser, surtout si l’on se situe dans un milieu scolaire, est d’inviter les vétérans à parler de leur expérience à un jeune public. Une anecdote intéressante à cet égard s’est produite il y a quelques années, dans une école secondaire en Ontario. Le professeur voulait présenter à ses élèves une vidéo relatant les exploits d’un soldat canadien nommé Smokey Smith. Ce dernier avait gagné la plus haute décoration militaire pour bravoure, soit la Croix de Victoria, sur le front italien dans les années 1940. Ce soldat avait tué à lui seul des dizaines d’Allemands, détruit quelques chars d’assaut, en plus de sauver la vie d’un camarade.
Le jour même du visionnement, le professeur avait invité Smokey Smith en personne pour voir le vidéo de ses exploits avec les élèves. Malheureusement, un contretemps est survenu, si bien que Smith s’est présenté dans la classe une fois le vidéo terminé. Un peu confus et gêné, le professeur s’est excusé à M. Smith, en lui disant que le temps filait et qu’il fallait passer la vidéo. Et sur un air un peu désinvolte, Smith a répondu : « Ah pas de problème Monsieur, je comprends,…et est-ce que le show était bon? »
Et ce même esprit de désinvolture et d’humilité est symbolique, parce qu’il témoigne en même temps qu’en dépit des souffrances et des séquelles physiques et psychologiques, il se trouve des vétérans capables de dédramatiser en quelque sorte ce qu’ils ont vécu. C’est ça que certains historiens qui étudient l’histoire militaire saisissent mal, c’est que la guerre est certes terrible, mais c’est également une époque, c’est-à-dire un contexte dans lequel des gens ont vécu.
Donc, lorsque l’on prend la peine de lire sur le sujet, de regarder un film ou un documentaire, ou d’écouter un professeur ou un conférencier en parler, on s’intéresse non seulement au conflit, mais aussi à tout l’aspect contextuel qui l’entoure. N’oubliez jamais que les soldats qui ont fait la guerre étaient des gens comme vous et moi. C’étaient des hommes qui ont dit des choses, qui ont fait des choses, qui avaient des opinions et des sentiments. La notion de « devoir de mémoire », c’est tout cela finalement.
Conclusion
En guise de conclusion, je rappellerais à quel point l’étude de l’histoire militaire peut-être fascinante, voire contagieuse, lorsque l’on prend la peine d’en explorer les diverses facettes, que ce soit du point de vue des soldats (comme on a vu ce soir) ou encore du point de vue des sociétés en guerre (que l’on pourrait aborder éventuellement).
C’est en ce sens que le simple intérêt que l’on peut porter à ce que nos ancêtres ont vécu sur les champs de bataille, et ce que nos militaires vivent actuellement en théâtre d’opérations, constitue un bon point de départ à toute exploration. Ici même, à la bibliothèque, j’ai recensé énormément d’ouvrages sur le sujet. Il y a certes Internet qui constitue une autre bonne source d’informations. Les vétérans eux-mêmes peuvent vous en apprendre, car, pour l’avoir vécu moi-même, ils ont une mémoire phénoménale.
Notre ville porte aussi des traces de ce passé militaire. Il suffit de regarder le monument se trouvant tout près d’ici, au coin du pont. Sur ce monument sont inscrits les noms de soldats de la région qui ne sont jamais revenus. Ce ne sont pas que des noms gravés sur la pierre, ce sont aussi des histoires qui s’inscrivent dans des contextes particuliers. Dites-vous qu’il n’y a rien de plus difficile émotionnellement pour un vétéran que de se promener devant un monument ou une pierre tombale, et d’y lire le nom d’un frère d’armes tombé à ses côtés.
Parce que non seulement ces Québécois se sont enrôlés parce qu’il n’y avait pas de job, mais ils ont fini par se battre pour leur pays, pour les valeurs en lesquelles ils croyaient au fond d’eux-mêmes. Dites-vous que dans le feu de l’action, dans le fond d’un trou, sous les balles et les obus, alors que gémissent les blessés et que la situation semble désespérée, eh bien ces hommes-là se sont battus pour leurs frères d’armes.
J’en ai eu la confirmation un jour où j’ai demandé à un vétéran s’il était un héros. Il m’a alors répondu : « Je ne sais pas Monsieur si j’étais un héros, mais je sais que j’ai servi parmi des héros. »
Je vous remercie.