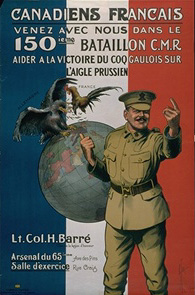Introduction
C’est un Paris humilié par la défaite et affamé par le blocus des Prussiens qui se trouve au bord de la révolution en février 1871, alors qu’une Assemblée nationale à majorité monarchiste vient d’être élue pour négocier la paix. La vie dans la capitale est malsaine, car la misère y règne avec une intensité telle que la révolution paraît inévitable. De la mi-février à la mi-mars, les Parisiens endurent les misères et déceptions nées du siège de la capitale. Ils doivent aussi supporter les maladresses d’une Assemblée sourde à leurs revendications, telles la suspension du moratoire des loyers et la suppression de la solde des Gardes nationaux, pour ne nommer que quelques facteurs ayant poussé à la révolution du 18 mars. Enfin, les tentatives de Versailles de reprendre les canons de Montmartre, appartenant à la Garde nationale, viendront mettre le feu aux poudres d’une révolution. De celle-ci émergera une Commune désireuse d’assurer à la population la garantie de l’autonomie municipale et de la République universelle.

C’est dans ce contexte de révolution et d’anarchie que le Comité central de la Garde nationale, seule force encore capable de restaurer l’ordre, se trouve en possession du pouvoir le 18 mars, trois jours après sa formation définitive. Ce conseil civil, seul « gouvernement de fait » placé à la tête d’une force armée de 200,000 hommes, veut cependant rendre légitime le pouvoir et propose de faire des élections en ce sens. Tenues le 26 mars, les élections aboutiront à la formation de la Commune de Paris qui ne fut pas uniquement un gouvernement insurrectionnel, mais davantage une tentative de gouvernement de tendance révolutionnaire à l’intérieur d’un cadre municipal. Ce gouvernement se dit être en dehors des griffes de l’État, sous l’auspice d’une confrontation des pouvoirs où le théorique (décisions, décrets, réflexions…) entra en conflit ouvert avec le pratique (pouvoir de la rue, actions, manœuvres…). Pour ma part, je crois que la Commune représentait le pouvoir du théorique et le Comité central le pouvoir d’ordre pratique.
Cette manière de voir les choses constitue, si l’on veut, un cadre méthodologique permettant de chercher et comprendre si, face aux responsabilités relatives au fonctionnement quotidien des services publics dans le cadre urbain parisien, le Comité central de la Garde nationale a adopté une attitude de gestion ou de surveillance, selon qu’il ait dû se confronter aux représentants de la Délégation (maires, adjoints et députés) ou à ceux de la Commune.
D’abord, le Comité central a dû gérer Paris entre le 18 et le 26 mars 1871. De cette date, la Commune prit la relève. Le problème, et c’est ce qui justifie toute cette problématique, est que l’attitude du Comité central n’est pas claire. Avant les élections du 26 mars, je pense qu’il a « géré » Paris, sauf que l’autonomie des arrondissements était encore assez forte. Sous la Commune, le Comité central a remis ses pouvoirs à cette dernière, mais en gardant toujours un œil sur les affaires, voire à en assurer l’administration. Le cas de l’administration de la Guerre (la défense de Paris) est percutant sur ce point.
Voilà donc pourquoi nous pouvons parler d’une « dualité des pouvoirs ». Au niveau du pouvoir politique, je pense que la Commune de Paris est génératrice d’un espace urbain se divisant en deux branches. Premièrement, que ce soit de manière directe ou non, il existait sous la Commune un type d’espace que nous pouvons qualifier de la rue. Cet espace met surtout en scène le Comité central dans l’application concrète du pouvoir. En d’autres termes, la gérance des décisions prises en haut relève de l’immédiat, du concret, de la prise de contact directe avec la rue. C’est tout le contraire du second type d’espace urbain que j’ai identifié. Cet espace, représenté dans un premier temps par la Délégation et ensuite par la Commune, est théorique et argumentaire. Il met l’accent sur la société civile, car il constitue un ensemble qui étudie les décisions au sens théorique sans se soucier nécessairement des conséquences dans la rue. Cet espace politique parisien est indirect, médiatisé et, on s’en doute, en conflit ouvert avec le premier type d’espace ayant pour acteur principal le Comité central.

Cette catégorisation en deux volets de l’espace urbain parisien n’est pas étanche, car le théorique et le pratique s’entrecoupent selon les circonstances, mais le portrait global demeure, soit que le Comité central travaille sur le terrain et la Commune dans les « décrets », à l’Hôtel de Ville. Notre approche pour une histoire politique de la ville est soutenue par une série de sources tels les Procès-verbaux et le Journal officiel de la Commune qui, bien que se contredisant entre elles quelques fois et ne rapportant pas fidèlement les décisions et gestes commis, n’en demeurent pas moins une mine d’or d’informations relatives à l’attitude du Comité central au cours des 73 jours que dura la Commune.
De la révolution aux élections: l’administration de Paris par le Comité central et les conflits juridictionnels avec les élus parisiens de la Délégation
Après l’échec de l’assaut contre Montmartre, Adolphe Thiers et le gouvernement évacuèrent Paris pour Versailles, laissant derrière une ville sans administration. Les maires, adjoints et députés parisiens élus à l’automne de 1870, et mieux connus sous le nom de Délégation, se sentaient légitimés à gouverner la capitale. Fort d’un appui populaire massif, le Comité central de la Garde nationale pense quant à lui être le plus apte à gérer Paris. C’est dans ce contexte que le Comité central fut placé à la tête de Paris entre le 18 et le 26 mars, jour des élections de la Commune.
Le programme politique du Comité central
Organe puissant d’une révolution qui prend de l’ampleur, le Comité central est placé à la tête de Paris avec un programme politique qu’il entend réaliser afin de montrer à la population qu’il sait respecter ses promesses. D’abord, le Comité central se composait de nouveaux venus en politique, peu préoccupés par les systèmes, mais soucieux de sauver la République. De plus, la plupart de ses membres ne voulaient pas prendre part à une direction effective des affaires, mais plutôt contrôler l’administration de la Garde nationale et des services publics. Plus précisément, les hommes du Comité central prônaient un programme à partir de deux thèmes centraux: sauver la République et assurer à Paris sa municipalité. Dans l’immédiat, le Comité central se proposait de combattre la misère du peuple parisien et son président, Édouard Moreau, résuma cette idée: « (…) faire les élections dans le plus bref délai, pourvoir aux services publics, préserver la ville d’une surprise. »
La question de préserver la République constituait pour le Comité central l’artère vitale de sa raison d’exister, dans la mesure où persistait la double menace des sièges prussien et versaillais autour de Paris. La partie théorique de son programme avance que le Comité central n’était pas responsable de la présente guerre civile, qu’il n’avait fait que répondre à une agression des Versaillais, qu’il a suivi le peuple en occupant l’Hôtel de Ville abandonné par Ferry et que Paris devenait le « symbole d’une thèse de complot contre la République », alors que Versailles voulait réduire au silence la capitale (décapitalisation, ruine du commerce, etc.).
N’ayant pas ou peu d’opposition sérieuse dans la capitale, et encore moins du côté de la Délégation, le Comité central doit s’appuyer sur ces bases afin de rendre concrète la gestion des affaires, car il se trouve seul aux commandes. En réponse à une question de Georges Clemenceau sur les intentions du Comité central, Eugène Varlin, le délégué aux Finances, réplique que son organisme veut un conseil municipal élu (confirmé par la rédaction d’une charte), des franchises communales pour Paris, la suppression de la Préfecture de Police, une plus grande autonomie pour la Garde nationale, un moratoire sur les paiements de loyers en dessous de 500 francs et le retrait de l’armée à vingt lieus de la capitale. Outre le dernier point, le Comité central s’efforça d’appliquer ce programme politique, malgré l’anarchie régnant dans Paris. Un de ses membres, Arthur Arnould, dit que ce programme gestionnaire n’a rien d’utopiste, car, dans pareille situation, la Délégation n’aurait pas mieux administré la capitale. Par ailleurs, le Comité central pouvait appliquer un certain nombre de mesures simples et efficaces voulues depuis longtemps par Paris comme: le droit d’association, le droit de réunion et la liberté de la presse et du citoyen.

Le programme du Comité central fut-il appliqué dans son intégralité? La réponse semble être non, car le temps manqua pour une tâche qui fut trop lourde. Le Comité central pouvait difficilement répondre aux attentes de Paris alors que la population désirait davantage. Selon W. Serman, Paris souhaitait l’abolition pure et simple de toute forme de gouvernement, même républicain, tout en se protégeant d’un éventuel rétablissement d’une autorité urbaine quelconque. Le nouvel espace politico-urbain de Paris devait se définir par une décentralisation massive de l’administration en passant par la régénération sociale fondée sur la paix et le travail, comme le proposait Charles Beslay du Comité central. En attendant, les intentions du Comité central étaient honnêtes quand celui-ci affirma, le 26 mars, que son mandat était terminé et qu’il confiait à des mains prétendument plus qualifiées le pouvoir dans la capitale.
Le programme politique de la Délégation
L’autorité légale, telle qu’elle se nommait, s’occupa pendant la semaine du 18 au 26 mars à bâtir un contre-argumentaire au programme politique du Comité central. La « priorité administrative » de la Délégation relève du théorique, dans la mesure où elle voulait voir le Comité central disparaître et elle jouait souvent la carte du mensonge en affirmant que Versailles reconnaissait certaines réclamations de Paris telles celles mentionnées précédemment. Dans les faits, c’est Clemenceau, maire du XVIIIe arrondissement, qui représente ou dissimule le mieux les intentions de la Délégation en recevant le 19 mars au soir les membres du Comité central. Clemenceau construit son argumentation en trois points, dont le premier vise directement la conduite du Comité central. Clemenceau lui dit qu’il fait fausse route, qu’il ne gère nullement Paris, qu’il est illégitime et responsable de la panique dans la population.
Le médecin-maire reconnaît par contre que Paris, et non le Comité central, a des revendications légitimes et que l’Assemblée nationale doit reconnaître le statut particulier de la métropole dans la France. Enfin, Clemenceau demande au Comité central de laisser sa place à la Délégation en promettant que celle-ci ira négocier avec Thiers toutes les concessions nécessaires. Cette promesse prit une forme plus concrète, le 22 mars, par la déclaration suivante des maires et députés dans le Journal officiel : « (…) nous avons résolu de demander aujourd’hui même à l’Assemblée nationale l’adoption de deux mesures qui, nous avons espoir, contribueront, si elles sont adoptées, à ramener le calme dans les esprits. Ces deux mesures sont: l’élection de tous les chefs de la Garde nationale et l’établissement d’un conseil municipal élu par tous les citoyens. »
Tous républicains, les maires et députés analysaient d’une manière réaliste la situation dans Paris. Benoît Malon, membre de la Délégation, dit à Varlin que seuls les élus de 1870 peuvent récupérer une partie des revendications, dont celle d’un conseil municipal élu et le report des échéances sur les loyers, mais sans pousser plus loin. Le 21 mars, le Journal officiel traduit cette attitude de la Délégation: « Nous estimons, en outre, que notre présence au poste que vos suffrages nous ont assigné ne saurait être inutile, soit qu’il s’agisse de consolider la République, soit qu’il y ait à la défendre. » Malon se base aussi sur une circulaire émise par le ministre de l’Intérieur Ernest Picard, le 19 mars, qui confiait de façon provisoire l’administration de Paris à la réunion des maires et députés. Ce désir d’un retour à la normale était le point central du programme de la Délégation qui n’a pu être appliqué, car le Comité central décida de faire les élections qui ont amené la Commune au pouvoir. La Délégation et le Comité central aspiraient tous deux à la légalité. Le premier disait déjà la détenir tandis que le second entendait y parvenir par les prochaines élections. Cette pression des maires et députés sur le Comité central constituait une autre revendication, soit celle de prendre la place de ce dernier.
L’Hôtel de Ville, les ministères et les mairies : lieux et symboles des enjeux politiques
Si les deux points précédents nous ont permis de saisir brièvement l’accaparement d’un espace politique théorique, via la promotion des programmes politiques respectifs, il faut également tenir compte de la prise de possession physique des lieux et symboles de l’espace politique parisien. Pour le Comité central, la possession de l’Hôtel de Ville, des ministères et des mairies influença la fixation des priorités administratives pendant la courte gestion des affaires du 18 au 26 mars 1871.
Cela dit, le départ du gouvernement Thiers pour Versailles laisse un vide dans Paris au 18 mars. Immédiatement, le Comité central envoie des hommes se saisir des édifices publics d’importance. Par exemple, des figures jusque-là inconnues de la politique parisienne (Jourde et Varlin aux Finances, Eudes à la Guerre, Duval et Rigault à l’ex-Préfecture de Police, Assis à l’Hôtel de Ville, etc.) iront s’emparer des lieux du pouvoir. L’occupation de l’Hôtel de Ville fixe d’entrée de jeu une priorité administrative qui consiste à rassurer la population: « Le nouveau Gouvernement de la République vient de prendre possession de tous les ministères (…) Cette occupation, opérée par la Garde nationale, impose de grands devoirs aux citoyens qui ont accepté cette tâche difficile. » Ensuite, il fallait organiser des élections: « Maître (le Comité central) du Palais municipal (…), sa première pensée fut d’abdiquer (…) et de convoquer les électeurs pour l’établissement d’une Assemblée communale qui prendrait sa place. »

La possession, mais surtout l’occupation obstinée des lieux du pouvoir, en attendant les élections, devient le prétexte d’un bras de fer livré avec la Délégation sur la question bien connue de la légitimité de ce « pouvoir ». Camille Pelletan résume ce début d’empoignade: « Qu’était-ce en effet que le pouvoir de l’Hôtel de Ville? Une assemblée municipale qui prétendait être une Assemblée politique souveraine. » C’est à ce moment que la Délégation voudra intensifier son désir de voir le Comité central quitter le pouvoir. Le 20 mars, au matin, le maire Bonvalet du IIIe arrondissement vint avec deux adjoints réclamer les franchises à l’Hôtel de Ville, en pensant que le Comité central, qui avait envoyé la veille quelques délégués pour discuter, allait céder.
L’occupation des édifices publics aurait dû, en théorie, faciliter la réorganisation de l’administration, mais le Comité central devait surveiller l’agitation constante des opposants à sa politique. À titre d’exemple, la mairie du IIe arrondissement fut un important bastion de résistance regroupant certains maires (Tirard, Dubreuil, Héligon) qui avaient récupéré les éléments fidèles de l’ordre afin de lancer une offensive contre l’Hôtel de Ville. Des endroits comme les rues Vivienne, Richelieu, du Quatre-Septembre, la Place Vendôme ainsi que la gare de Saint-Lazare constituaient des postes avancés des forces de la Délégation. Autrement dit, la possession de l’Hôtel de Ville et des ministères, censés être les bâtiments les plus importants, n’empêcha pas la résistance dans les quartiers, où des mairies (IXe et XVIe arrondissements) se présentaient comme des bâtons dans les roues du Comité central.
Les clés du pouvoir et les autonomies municipales
L’occupation de l’Hôtel de Ville et des ministères par la Garde nationale donna l’opportunité à son comité central de freiner l’élan de la Délégation dans ses tentatives de récupérer le pouvoir. Or, cette centralisation du pouvoir n’empêcha pas cependant les municipalités ou arrondissements de Paris de garder une certaine forme d’autonomie dans la gestion des affaires courantes. Autrement dit, la Délégation semble détenir quelque pouvoir via les mairies, mais celui-ci peut être contré par l’action des institutions politiques occupées physiquement par la Garde nationale.
La désorganisation de l’administration parisienne, suite au départ des fonctionnaires et au sabotage des cachets, registres et caisses des mairies, obligea le Comité central à tout réorganiser (octroi, voirie, éclairage, assistance publique, etc.). Par contre, bien que le Comité central pouvait assurer une sécurité physique contre une agression de l’extérieur, les mairies étaient encore les symboles de la sécurité sociale tant recherchée (nourriture, habillement et logement). Ces autonomies municipales, que tente de garder la Délégation et que veut récupérer le Comité central, existent amplement depuis septembre 1870, car « (…) le peuple a progressivement créé les cadres communautaires et libertaires de sa vie quotidienne, en marge des institutions régulières sur les bases de la fraternité et du principe fédératif. » Les institutions parisiennes ne disparaissent pas pour autant, mais elles doivent se plier à l’idée communaliste, donc aux principes de gestion en commun de l’administration parisienne.
Malgré ses efforts, la Délégation perdait progressivement de sa puissance et n’était plus en mesure d’orienter la population vers ses vues. Le Comité central a par conséquent géré Paris en comblant les vides dans les ministères, mais il a dû contrôler l’action de la résistance qui voulait l’empêcher de faire des élections. Le résultat de la victoire du Comité central sur la Délégation se traduit dans ce manifeste du 25 mars : « Le Comité central de la Garde nationale, auquel se sont ralliés les députés de Paris, les maires et adjoints, convaincus que le seul moyen d’éviter la guerre civile, l’effusion de sang à Paris et, en même temps, d’affermir la République, est de procéder à des élections immédiates, convoque pour dimanche (26 mars) tous les citoyens dans les collèges électoraux. »
Entre surveillance et gestion : la place du Comité central dans la répartition des services publics parisiens et les relations avec les arrondissements
La journée du 26 mars 1871 est donc celle de l’élection de la Commune de Paris, qui sera proclamée officiellement deux jours plus tard. Le « danger » de la Délégation est maintenant écarté et il se passe une période de transition entre ces deux journées afin de laisser du temps aux élus de la Commune dans chaque arrondissement de prendre leur place à l’Hôtel de Ville. Normalement, le Comité central laisse ses pouvoirs à la Commune sauf qu’il continue de garder un œil sur les affaires, notamment en ce qui a trait aux commissions communales (« ministères ») et aux relations avec les municipalités.
L’étendue des pouvoirs des commissions communales : quelques exemples
L’étude des pouvoirs réels détenus par chacune des commissions communales est révélatrice de l’influence du Comité central, qui tente de contrôler tant bien que mal les affaires. Le premier constat est simple: l’ampleur du travail est écrasante. Les besoins de Paris sous la Commune sont nombreux, comme: le vote du budget, la fixation et la répartition des impôts, l’organisation de la magistrature et de la police, la garantie des libertés individuelles, l’organisation de la défense urbaine, etc. Ce sont donc neuf commissions qui doivent se partager l’exercice du pouvoir et chaque délégué passe la majorité de son temps à faire la navette entre l’Hôtel de Ville, son bureau de commission et les mairies.
Selon Max Pol-Flouchet, cette articulation de l’administration devait se découper en trois plans hiérarchiques, en passant de la rue aux décrets: 1) les membres de la Commune et leurs relations avec les arrondissements (plan horizontal); 2) la création de neuf commissions se partageant les affaires au niveau de la cité (plan vertical); 3) une commission exécutive de 19 membres coordonnant le tout (plan central). Le problème le plus urgent à régler implique directement le Comité central au niveau de la solde des Gardes nationaux. Varlin et Jourde, délégués aux Finances, doivent d’abord, pour ne pas mettre inutilement de la pression sur les coffres du Trésor public de Paris, emprunter au banquier Rothschild la somme de 500,000 francs pour régler les comptes immédiats. Cet événement se passait avant les élections du 26 mars et c’est que qui nous amène à croire que le Comité central voulait d’autant plus garder un œil sur l’action des gens dont la tâche était de verser la solde aux Gardes nationaux sous la nouvelle Commune.

Au niveau des services publics, Jules Andrieu, commissaire à cette tâche, se plaint de l’anarchie qui règne dans Paris sous la forme d’une mauvaise division du travail et accuse le Comité central d’en être responsable : « (…) on reconnaîtra sans peine dans cette mauvaise classification des besoins d’une grande cité, voulant vivre en gardant son autonomie, l’insuffisance politique et administrative qui avait présidé à la création de ces neufs rouages (commissions), dont quelques-uns étaient superflus et dont beaucoup se contrariaient les uns les autres. La division du travail communal qu’avait faite le Comité central et qu’avait conservée la Commune était malheureusement calquée sur le double groupement municipal et gouvernemental des administrations des anciens régimes. »
La vision idéale qu’avait Andrieu d’une organisation communale efficace devait faire fi de tout antagonisme entre le Comité central et la Commune. Il va même jusqu’à dire que les membres les plus doués du Comité central auraient dû siéger pleinement aux postes dont on croyait déceler certaines compétences. Cela éviterait de sentir constamment le poids du contrôle pour passer à celui d’une gestion en continuité avec ce qui s’était passé avant le 26 mars. Le problème était justement que ce qui s’était produit avant le 26 mars était le fruit des actions du Comité central pour la capitale. Voulait-il perdre ses acquis, ses réalisations administratives au profit d’une Commune composée de 80 membres et dont seulement une vingtaine venait directement de ses rangs? Il est peut-être plus facile, dans ce contexte, de comprendre pourquoi le Comité central a alors eu « peur » de se voir reléguer au second rang, à la simple administration de la Garde nationale dont il émane.
Ce que dénonçaient par ailleurs certains membres du Comité central était la façon dont on nommait les fonctionnaires communaux. Il n’y avait aucun des principes démocratiques connus dans la nomination de ceux-ci. L’élection ou le concours ne faisaient pas partie des procédures d’embauche sous la Commune et le tout se faisait de façon arbitraire, souvent par un décret, que l’on peut associer à du patronage. Par exemple, le service télégraphique, selon Andrieu, était en si mauvais état qu’il devenait abandonné: « (…) à des vanités incompétentes et au système des élections si déplorables quand il ne s’arme pas de la garantie d’examens préalables (…) » Cette manière de procéder, combinée avec le « vide administratif qui caractérise la capitale au lendemain de l’insurrection », amène le Journal officiel à publier, le 25 avril par la voix de son Directeur: « (…) le devoir pénible, mais aujourd’hui nécessaire, de sonder la conscience du fonctionnaire, afin d’assurer les intérêts généraux de l’administration et de justifier la confiance mise en nous par la Commune de Paris et par le peuple. » Que pouvait faire le Comité central devant les accusations d’ingérence qu’on lui portait, alors qu’il ne faisait que constater une situation de débordements causés par l’incompétence et le manque d’effectifs de l’administration?
Malgré toutes les défaillances des commissions communales dans les circonstances, Jean Bruhat trace un portrait somme toute positif des 73 jours que dura la Commune. Il cite les cas du délégué Viard, qui assura le service des subsistances en luttant contre la spéculation et les taxes exagérées, tout en faisant appel au concert des municipalités. Le ciseleur Theisz s’occupa des Postes avec un brio tel qu’il remit, selon Bruhat, les services en marche en 48 heures. La Santé, sous la direction de Treillard, était vidée de son parc d’ambulances (situé au Palais de l’Industrie), mais put néanmoins réorganiser les services, notamment aux soins apportés aux nombreux soldats blessés.
Les municipalités, la Commune et le pouvoir autonome : la place du Comité central dans ce processus
Le Comité central n’est pas uniquement aux prises avec les commissions communales, car il désire aussi surveiller la réorganisation forcée des administrations municipales dans ce contexte de révolution. En fait, le Comité central voulait, selon W. Serman, « institutionnaliser l’anarchie » en renonçant à gouverner les hommes pour n’administrer que les choses, la matérialité.
C’est avec cette pesante dualité des pouvoirs entre le Comité central et la Commune que les municipalités de Paris doivent vivre au jour le jour. Dans ses relations avec les arrondissements, la Commune fixe le 30 mars les règles qui visent à s’assurer de la direction administrative de chaque municipalité, de l’adjonction à chacune d’elle des commissions pour l’expédition des affaires et, enfin, de la bonne gérance des actes de l’état civil. Cette déclaration ne limite pas cependant le pouvoir de fait constitué par le Comité central, et ce, malgré sa promesse de se retirer après l’avènement de la Commune. Cette dernière a souvent accusé les municipalités de ne pas appliquer les décisions prises en haut. Or, dans les faits, le Comité central est en partie responsable de la discorde ainsi causée. Par exemple, la Commune voulait que les municipalités se chargent de l’organisation civile de la défense des quartiers. Outre le cas du Ve arrondissement, le pouvoir civil n’a jamais pu prendre concrètement la direction des légions, car le Comité central exerçait sur elles un contrôle déjà effectif. Plus tard, le 16 avril, la Commune demande à nouveau aux municipalités de gérer les Conseils de légion contre ceux refusant de se battre. Ce décret communal vient mettre le feu aux poudres dans les relations entre le Comité central et les municipalités, car, selon le Comité, les Conseils de légion relèvent de l’organisation interne de la Garde nationale et, en somme, les arrondissements (le pouvoir civil) n’ont rien à voir dans le domaine militaire.

Un autre problème résidait dans le fait que la Commune avait confié aux municipalités le soin de réquisitionner les armes et de poursuivre les réfractaires. Encore une fois, le Comité central, pour les mêmes raisons, s’insurge devant ce problème de juridiction. Pire encore, les municipalités prenaient parfois les devants quand il s’agissait de nommer les chefs des légions. La réorganisation des bataillons passait d’abord par la nomination d’un chef. Celui-ci devait, en théorie, être élu par le Comité central de la Garde nationale, mais les arrondissements nommaient parfois les dirigeants sans consulter le Comité central. Il n’y a, selon André Decouflé, que deux arrondissements (les IXe et XIe), qui obéirent au doigt et à l’œil aux décrets de la Commune. Le IXe avait perquisitionné à domicile les armes et équipements militaires, tandis que le XIe ordonna à la Garde nationale d’évacuer les églises, temples et synagogues de sa municipalité.
Le terrain de l’enseignement offrit d’autres possibilités de conflits à trois. Plus précisément, les questions de la laïcité et de l’enseignement professionnel posèrent des tracas. La Commune voulait, dans un premier temps, centraliser le dossier du recrutement des maîtres. La plupart des municipalités adhéraient au principe de la promotion de la laïcité de l’enseignement sauf que le délégué communal à la question, Vaillant, s’empressa de devancer ces dernières. Bien que les historiens n’en fassent guère mention, je pense que le Comité central était préoccupé par la question de l’enseignement, dans la mesure où celui-ci tenait fièrement à défendre les principes classiques de la Révolution et que c’est l’école, organe performant de diffusion, qui devait s’en charger. Voilà donc pourquoi les municipalités qui ne voulaient pas adhérer à la laïcité de l’enseignement faisaient l’objet d’une surveillance plus étroite selon mon hypothèse.
Par ailleurs, la Commune ne cherche pas à froisser les libertés religieuses. Cependant, des arrondissements comme le IVe s’écartaient des décrets communaux en affirmant simplement la « neutralité de l’école publique ». Plus libérale encore, la municipalité du VIIIe arrondissement, dirigée par l’excentrique Jules Allix, admettait la coexistence des écoles laïques et confessionnelles. Quant aux XIIIe et XVe arrondissements, ceux-ci prônaient l’enseignement confessionnel et rejetaient les tentatives du pouvoir central de laïciser l’éducation. Nous avons donc un portrait se divisant en trois catégories bien distinctes, où le Comité central avait des intérêts à défendre, selon la politique éducationnelle adoptée, car de là dépendait le bon cheminement de la révolution.
Les membres de la Commune sont déchirés entre eux quant à l’attitude à adopter face aux municipalités. Pour le citoyen Lefrançais, il importe que les arrondissements soient autonomes afin de pourvoir aux besoins de la population. Beslay, le doyen des communards, pense plutôt qu’il ne faut pas laisser d’autorité aux municipalités. La question des douanes stigmatise encore une fois cette opposition lors des réunions tenues à l’Hôtel de Ville. Par exemple: « Le citoyen Meillet donne lecture d’une lettre, au sujet d’un nouvel empiétement du Comité central, qui prétend se réserver le droit de viser les passeports. Un citoyen, ayant un passeport en règle de la Commune, n’a pu passer aux portes de Paris, parce que son passeport ne portait pas les cachets de la douzième légion. »
Ce fait survenu dans le XIIe arrondissement à la porte de Vincennes n’est qu’un exemple d’une accumulation d’incidents, si l’on se rapporte aux Procès-verbaux. Cluseret, délégué à la Guerre, statuait sur l’interdiction faite à la Garde nationale d’entraver le commerce dans les gardes et postes frontaliers. Dorénavant, cette forme de « guerre non officielle », mais bien présente entre la Commune et le Comité central ira en s’accentuant jusqu’au 21 mai, date à laquelle les troupes versaillaises entrèrent dans Paris. Edward S. Mason résume la situation: « In addition to the municipal commission, every arrondissement has its Legion Council and Legion General Staff, under the general supervision of the Central Committee. These organizations had a finger in the administration and the inexact division of function was a cause of considerable friction. »
(La suite dans la seconde partie.)