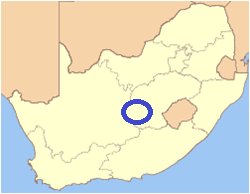Dans la victoire comme dans la défaite, la discipline est un élément fondamental au bon fonctionnement des armées. Elle résulte de la formation, de l’endoctrinement et de l’encouragement, via un système de récompenses et de punitions, destinés aux soldats et futurs membres des forces armées. Dans l’univers militaire, la discipline comporte un ensemble de pratiques qui sont compatibles avec les fins pour lesquelles un militaire peut être employé, de sorte que la réponse désirée peut résulter d’une initiative du soldat ou être imposée par l’autorité supérieure hiérarchique. Finalement, le non-respect des règles établies par les autorités se traduit par une forme de punition militaire.
Dans la victoire comme dans la défaite, la discipline est un élément fondamental au bon fonctionnement des armées. Elle résulte de la formation, de l’endoctrinement et de l’encouragement, via un système de récompenses et de punitions, destinés aux soldats et futurs membres des forces armées. Dans l’univers militaire, la discipline comporte un ensemble de pratiques qui sont compatibles avec les fins pour lesquelles un militaire peut être employé, de sorte que la réponse désirée peut résulter d’une initiative du soldat ou être imposée par l’autorité supérieure hiérarchique. Finalement, le non-respect des règles établies par les autorités se traduit par une forme de punition militaire.
La discipline: approches initiales
La conception et l’application de la discipline ont évolué avec le temps, en fonction des endroits et des cultures, si bien qu’une définition unique pouvant s’appliquer à toutes les armées et marines du monde n’existe pas. Cependant, il est possible d’établir quelques généralisations, ne serait-ce que pour donner un portrait d’ensemble de ce qu’est ou aurait pu être la discipline aux armées.
La discipline est cruciale au bon fonctionnement de n’importe quelle force armée. Elle fut implantée, dans la plupart des armées, par une combinaison d’exercices physiques et mentaux exécutés à répétition. Par conséquent, des punitions étaient prévues pour avoir manqué à l’accomplissement ou à la réussite de tels exercices. Les aspects physique, mental et répétitif des exercices constituent trois facteurs primaires qui fonctionnent en conjonction avec chacun d’entre eux et à l’intérieur d’un cadre militaire contextuel qui comprend un certain nombre de soldats dans le but de les habituer à travailler en équipe.
Ces soldats apprennent à vivre et à tout faire ensemble. Ils forment un groupe dont chacun des éléments peut venir en aide à ceux qui sont en difficultés, toujours dans le but de répondre aux défis et obstacles qui se présentent sur leur parcours. Dans ce cadre général, on exigera des soldats qu’ils atteignent des standards élevés dans l’utilisation de leurs armes et le soin qu’ils apportent à leur forme physique et à l’entretien de leurs équipements. Cela est fait non seulement pour améliorer leur efficacité au combat, mais aussi pour augmenter la qualité du commandement des officiers qui ont à diriger ces soldats. Le but étant encore une fois d’avoir des soldats capables d’entreprendre de longues campagnes sans qu’ils soient susceptibles de tomber sous les coups de la maladie, de l’inconfort patent ou de la malnutrition. En d’autres termes, si les soldats parviennent à accomplir, par la discipline, des tâches aussi simples que d’entretenir leurs équipements, vêtements et personnes, alors leurs officiers peuvent se concentrer sur d’autres tâches liées aux combats et ainsi améliorer l’efficacité de l’ensemble des forces.

Une fois la période de l’entraînement achevée, la discipline continue de s’appliquer et d’avoir un rôle déterminant dans la cohésion et l’efficacité d’une unité. Chaque individu est responsable de ses actes et il devient imputable à l’unité par le sentiment de camaraderie qui lie les soldats. De plus, l’autodiscipline que le soldat finit par développer à la dure lui permet d’anticiper la menace continue que représentent les punitions. Celles-ci forment des parties intégrantes du système militaire. Le cas le plus flagrant illustrant ces facteurs apparaît lorsqu’un soldat déserte son unité. La très dure sentence qui fut traditionnellement réservée pour cet acte devait normalement décourager le soldat de quitter son unité ou son poste, et ce, peu importe les circonstances.
La discipline par l’exemple

À travers les siècles, toutes sortes de formes de mesures disciplinaires ont été utilisées afin de forcer les hommes à obéir aux ordres, la plupart du temps par la punition physique ou l’humiliation. Par exemple, lors de la Guerre civile américaine, une manière plutôt inhabituelle et humiliante de punir des soldats consistait à leur tirer dessus avec des cartouches de sel, qu’on utilise normalement à la chasse. Parallèlement, une autre forme de punition pratiquée pendant ce conflit consistait à accrocher sur le soldat fautif une pancarte avec l’inscription « Déserteur » (ou autres inscriptions dégradantes) et à le faire marcher autour d’un baril, et ce, devant le regard de ses camarades. À l’inconfort physique associé à cette punition devait donc s’ajouter l’humiliation, surtout à une époque où l’honneur et la dignité étaient des valeurs importantes. Encore une fois, la discipline était de mise et se voulait une façon de décourager les autres en leur montrant les conséquences concrètes de ce qui pouvait arriver si l’on n’accomplissait pas son devoir.
Les exemples d’application de méthodes disciplinaires à travers l’Histoire sont pour ainsi dire infinis. À lui seul, le cinéma a contribué à présenter au grand public des interprétations forcément subjectives de l’application de telles méthodes. À titre d’exemple, pensons à des films comme Full Metal Jacket et Paths of Glory du réalisateur Stanley Kubrick. Ces films illustrent l’importance de la discipline par l’exemple au sein d’une unité militaire et surtout les graves conséquences qui peuvent s’abattre sur ceux qui refusent d’obtempérer aux règlements des autorités.
À une autre époque, celle de l’Antiquité, des chefs de guerre comme Hannibal étaient réputés pour la sévérité de la discipline appliquée dans leurs rangs. Dans ce cas spécifique, les forces expérimentées et disciplinées de Hannibal parvinrent à remporter leur plus grande victoire contre une armée romaine largement supérieure en nombre, mais combien minée par l’indiscipline et des problèmes au niveau de la chaîne de commandement à Cannes en 216 avant J.-C. Le fait que Hannibal savait qu’il pouvait compter sur l’excellente discipline ses troupes lui permettait d’exercer un commandement sans nécessairement être physiquement présent avec telle ou telle unité. Sans trop d’hésitation, le Carthaginois pouvait diriger à distance et ordonner des manœuvres. Il savait que les ordres seraient exécutés sans craindre de perdre le contrôle des opérations. Le jugement fut sans appel à Cannes.
Sous le feu ennemi
Dans un autre ordre d’idées, on peut penser à la discipline des archers anglais à Agincourt (1415) ou à celle de l’infanterie prussienne de Frédéric le Grand au cours de la Guerre de Sept ans (1756-1763). Ces deux cas sont connus pour être des exemples pertinents de forces armées qui ont su garder leur calme et leur cohésion sous le feu ennemi, tout en maintenant une discipline sans faille dans des situations incertaines. La discipline est un élément fondamental sur le champ de bataille, un élément sans lequel un commandant en est réduit à livrer un engagement dans lequel il contrôle mal ses propres éléments. En plus de subir de lourdes pertes, si des troupes initialement indisciplinées subissent quelconque pression, elles peuvent déserter en masse, laissant à l’ennemi le soin de récolter facilement les fruits de la victoire.
Un autre exemple de cette situation se produisit à la bataille d’Austerlitz en 1805. Là-bas, Napoléon parvint à battre une armée ennemie coalisée en exploitant les problèmes de discipline qui gangrénaient les forces russe et autrichienne. Napoléon disposait de soldats vétérans qui pouvaient aisément maintenir la discipline et la cohésion, ce qui leur permit d’encaisser le tir ennemi avec calme, mais aussi de contre-attaquer au moment opportun avec des effets dévastateurs. Par contre, dix années plus tard, à Waterloo, une force britannique disciplinée, qui par surcroît avait été abandonnée par quelques-uns de ses alliés, avait réussi à subir le feu français pendant plusieurs heures sans se désintégrer, jusqu’à ce que l’arrivée tardive des Prussiens anéantisse la croyance que se faisait Napoléon en la victoire de la Grande Armée.

Perceptions actuelles de la discipline
La discipline était normalement appliquée par une combinaison de sanctions formelles (allant de procédures sommaires jusqu’à la cour martiale) et informelles, parfois brutales et coercitives. Les aspects brutaux et coercitifs de l’application de la discipline ont officiellement été bannis des forces armées occidentales modernes, bien qu’ailleurs, comme dans l’armée russe, des controverses resurgissent de temps à autre sur des incidents que l’on présente comme « isolés ».
De nos jours, les forces armées des états démocratiques perçoivent la discipline et ses applications légales au cœur, sinon à l’avant-scène, des relations qu’elles entretiennent avec les sociétés qu’elles servent et protègent. Le citoyen qui s’enrôle sur une base volontaire consent implicitement à un engagement de « fiabilité inconditionnelle » qui l’oblige à prendre des risques que ses pairs dans la société civile n’oseraient pas nécessairement accepter. Par ailleurs, cela signifie que la discipline militaire requiert certains standards qui apparaissent plus élevés et qui n’ont pas d’égal ailleurs dans la société civile.
Cela ne signifie en rien que la discipline militaire soit opaque au point de demander à un homme d’accomplir une tâche hors de proportions de ses capacités physiques ou intellectuelles, ou des tâches qui seraient moralement pas correctes. De nos jours, il existe des mécanismes légaux qui permettent à un militaire de refuser d’obéir à un ordre si sa conscience lui indique de ne pas aller de l’avant. En d’autres mots, les militaires admettent qu’une discipline rigide et aveugle n’est ni militairement appropriée, ni socialement et politiquement acceptable. Il est aussi admis que l’autodiscipline a ses mérites particuliers, en ce sens où elle est le produit de valeurs, d’un code d’honneur personnel, d’une obligation morale et d’une fierté professionnelle à servir sous les drapeaux. Souvent, ces derniers facteurs contribuent à produire des individus naturellement disciplinés, puisque la motivation à servir les protège partiellement des conséquences de l’indiscipline.
Bref, la discipline est le ciment des forces armées. Elle doit être un élément à toujours prendre en compte dans l’analyse des batailles. À elle seule, la capacité à demeurer collectivement calme sous le feu ennemi, sans nécessairement assurer la victoire, empêche indubitablement le désastre.